LHAC
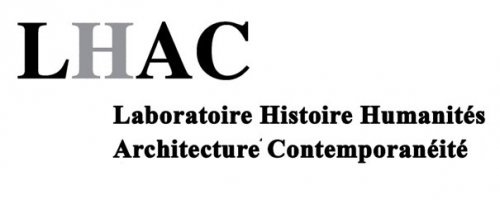
Créé en 1985, le LHAC est l'un des deux laboratoires de recherche de l'École nationale supérieure d'architecture de Nancy. Depuis de nombreuses années, il a investi des champs de recherche inexplorés et s'est spécialisé dans le domaine de l'histoire de l'architecture et de l'urbanisme – principalement du XXe siècle –, comme l'illustre la première déclinaison de son acronyme : laboratoire d'histoire de l'architecture contemporaine. En 2022, le LHAC prend acte d'un élargissement de ses champs disciplinaires et des thématiques abordées par ses chercheurs et le marque par une nouvelle déclinaison de son acronyme : laboratoire histoire humanités architecture contemporanéité.
Au travers de projets de recherche, de publications, de conférences et d'expositions ainsi que d'autres activités telles que des études appliquées (expertises et inventaires notamment), le LHAC s'implique dans de nombreux domaines avec la volonté de faire progresser la culture architecturale passée et présente et les « humanités » au sens large, en les appréhendant en tant que champs de théories, de techniques constructives, de cultures professionnelles ou d'enseignement.
En abordant ces thèmes par le prisme d'une approche méthodologique pluridisciplinaire permettant la synergie des méthodes et des outils de recherche hérités de l'histoire, de l'urbanisme, de la sociologie, de l'anthropologie ou encore de la philosophie, le LHAC questionne ce qui fait « contemporanéité », en lien étroit avec les exigences actuelles du cadre bâti et les mutations contemporaines, qu'elles soient professionnelles ou sociétales, culturelles ou environnementales.
Le laboratoire contribue aux programmes d'enseignement et de recherche de l'ENSA Nancy, et s'implique dans la diffusion de connaissances auprès d'un public large et aux côtés de ses principaux partenaires, investis notamment à l'échelle de la région Grand Est et dans les territoires transfrontaliers. Le LHAC est rattaché à l'École doctorale Humanités Nouvelles - Fernand Braudel de l'Université de Lorraine depuis 2013, ce qui lui permet d'accueillir des doctorants.
Depuis 2020, il s'appuie également sur le réseau fédéré autour de la chaire partenariale « Nouvelles Ruralités : Architectures et Milieux Vivants », fruit d'une collaboration scientifique, pédagogique et de terrain réunissant l'ENSA Nancy, l'ENSAIA Nancy et AgroParisTech Nancy. Cette chaire explore la ruralité sous ses dimensions architecturales, territoriales, sociétales et économiques, en considérant les nouveaux équilibres à instaurer entre métropoles et territoires ruraux comme une problématique prioritaire.
-
Cécile Fries-Paiola, co-directrice
du laboratoire
cecile.fries@nancy.archi.fr -
Lucile Pierron, co-directrice
du laboratoire
lucile.pierron@nancy.archi.fr
-
Julie AMBAL, directrice de la recherche
julie.ambal@nancy.archi.fr -
Cynthia MARTIN, chargée de la valorisation et des partenariats scientifiques
cynthia.martin@nancy.archi.fr
Adresse postale :
2 rue Bastien-Lepage
BP 40435
54001 Nancy Cedex
Plus d'informations :
Projet scientifique du LHAC
Projets de recherche
Projets de recherche
L'architecture scolaire au temps de la Covid-19
L'architecture scolaire au temps de la Covid-19
au temps de la Covid-19

Une salle de classe dans une école primaire à Malzéville. Photo : B. Comtesse.
Le projet «Architecture et enseignements alternatifs : comment définir de nouveaux espaces d'apprentissage dans un contexte de crise épidémique ?» présenté par le LHAC est lauréat de l'appel à projets Résilience organisé par la Région Grand Est et l'Agence Nationale de la Recherche en juillet 2020.
[Blog] Pour suivre l'avancée du projet de recherche : cliquez ici.
[Temps forts]
> 8 mars 2022 / conférence de matali crasset intitulée Transmission organique
> 8 mars 2022 / Jury du concours d'idées «Ecosystèmes d'enseignement extérieurs » présidé par matali crasset
> 19 octobre 2021 / Lancement du concours d'idées « Ecosystèmes d'enseignement extérieurs »











La crise sanitaire actuellement en cours, découlant de la diffusion à l'échelle mondiale de la maladie à coronavirus Covid-19, engendre de profondes évolutions dans les rapports que chacun entretient avec l'autre et avec l'espace. Comment, dans ce contexte, continuer à développer des liens de confiance et de sociabilité ? Comment repenser les espaces de l'enseignement, primaire, secondaire et supérieur ? Quelles évolutions des dispositifs spatiaux seraient susceptibles d'assurer tout à la fois la sécurité sanitaire et les besoins en matière de liens sociaux des élèves, des enseignants et des différents personnels engagés dans le domaine de l'enseignement ?
Ce projet propose ainsi dans un premier temps, de porter un regard rétrospectif sur l'histoire du mouvement hygiéniste qui, au cours des XIXe et XXe siècles, a eu une influence considérable sur l'urbanisme et l'architecture modernes ; il a également généré de nouveaux dispositifs spatiaux adaptés à l'enseignement et imaginés pour être optimaux en matière d'hygiène comme « les écoles de plein air ». L'analyse de tels dispositifs expérimentaux parfois sous-exploités ou oubliés nourrira les deux autres phases de la recherche.
Le second axe étudie les impacts socio-spatiaux contemporains de l'épidémie dans les milieux scolaires et les mécanismes d'adaptation mis en oeuvre par l'ensemble des acteurs de l'éducation : il s'agit d'observer et d'analyser les changements représentationnels et pratiques, à la fois sur le versant pédagogique et sur celui des sociabilités, dans le champ de l'éducation en contexte sanitaire épidémique. Il consiste ainsi en une vaste étude de terrain, permettant la collecte de données spatiales de type relevés architecturaux mais aussi sociales, grâce à l'observation in situ, à l'analyse des contextes et à la collecte des témoignages des acteurs. Une place importante est accordée au recueil de la parole des différentes catégories d'usagers.
Enfin, le troisième axe propose d'expérimenter des dispositifs spatiaux imaginés grâce aux observations issues des deux premières phases de recherche, grâce à une collaboration interdisciplinaire. Il s'agit donc de croiser les résultats des axes précédents pour identifier des situations sociales, spatiales et territoriales plus favorables que d'autres à la résilience, au développement de sociabilités (y compris en situation de crise), aux appropriations pédagogiques, ou encore qui tentent de proposer un rapport spécifique à la nature. Des configurations spatiales spécifiques sont alors proposées à l'expérimentation et mises en situation de test. La question principale qui sous-tend cette démarche est donc la suivante: comment concevoir des espaces de l'enseignement permettant de répondre aux enjeux sanitaires, sans renoncer aux enjeux de développement de la sociabilité et de soutenabilité des rapports à la nature?
Responsables du projet au LHAC :
- Vincent BRADEL, ancien directeur du LHAC, maître de conférences, docteur et chercheur, architecte de formation, historien, spécialiste de l'histoire des villes,
- Maribel CASAS, docteur et chercheur associée, architecte de formation, historienne, spécialiste de l'histoire de l'architecture,
- Catherine DESCHAMPS, co-directrice du LHAC, professeur HDR et chercheur, sociologue,
- Cécile FRIES-PAIOLA, maître de conférences associée, docteur et chercheur, architecte de formation, sociologue,
- Karine THILLEUL, co-directrice du LHAC, maître de conférences, docteur et chercheur, architecte de formation, historienne, spécialiste de l'histoire de l'architecture,
Equipe de recherche :
- Maribel CASAS, docteur et chercheur associée, architecte de formation, historienne, spécialiste de l'histoire de l'architecture,
- Karine THILLEUL, maître de conférences, docteur et chercheur, architecte de formation, historienne, spécialiste de l'histoire de l'architecture,
- Cécile FRIES-PAIOLA, maître de conférences associée, docteur et chercheur, architecte de formation, sociologue,
- Virgine DERVEAUX, enseignante à l'ENSA-Nancy et chercheure associée au LHAC),
- Gonzalo MORALES SOTOMAYOR, architecte DE, ingénieur d'études
- Melissa BELLESI, docteure en architecture, et doctorante au SnT, Université de Luxembourg
- Sylvie DOUSSET, professeure en sciences des sols, chercheure au LIEC, Université de Lorraine

