 Les ministres de la Culture et de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ont confié à l'inspection générale des affaires culturelles et à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, une mission relative aux conditions de déroulement et à l'organisation de la formation dans les 20 Écoles nationales supérieures d'architecture (ENSA), placées sous la tutelle de leurs deux ministères.
Les ministres de la Culture et de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation ont confié à l'inspection générale des affaires culturelles et à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche, une mission relative aux conditions de déroulement et à l'organisation de la formation dans les 20 Écoles nationales supérieures d'architecture (ENSA), placées sous la tutelle de leurs deux ministères.Cette mission fait suite au rapport de l'IGAC de 2020 dressant un bilan d'étape de la mise en oeuvre de la réforme de la gouvernance des écoles et du statut des enseignants des ENSA en 2018 et s'inscrit dans un contexte d'évolution rapide et profonde du métier d'architecte. Cette évolution procède notamment des exigences de la société en termes de qualité du logement, d'adaptation des normes du bâti, de rénovation et de réhabilitation, d'objectifs de développement durable, des demandes accrues de technicité et d'innovation souvent portées par d'autres acteurs de la chaîne du bâtiment et des travaux publics, particulièrement les bureaux d'études spécialisés, et du rôle croissant des technologies numériques dans l'exercice du métier.
Les 29 propositions du rapport doivent permettre aux écoles d'être à l'avenir pleinement actrices du développement de la profession d'architecte et de l'affirmation de son rôle social. Elles doivent s'inscrire dans la mise en place du « Nouveau Bauhaus » européen qui puise dans son histoire propre le rappel de la responsabilité créative et sociale de l'architecte, en mobilisant les savoirs et les techniques d'aujourd'hui pour répondre aux enjeux sociétaux et d'amélioration du cadre de vie de demain.
// La réforme des Écoles nationales supérieures d'architecture (ENSA) de 2018 - Bilan d'étape - nov 2020
Rapport établi par François Hurard et Benoit Paumier, inspecteurs généraux des affaires culturelles
>> Télécharger le rapport IGAC 2020 - 18
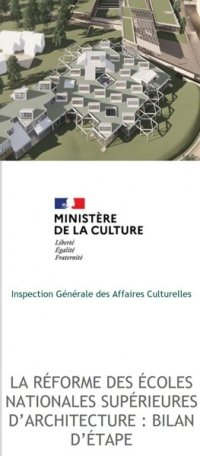 Ce rapport, consacré à un premier bilan de la mise en oeuvre des décrets de février 2018 réformant les 20 écoles nationales supérieures d'architecture, constate que la réforme fait l'objet d'un consensus confirmé sur ses deux volets principaux : l'instauration d'une gouvernance des écoles plus participative, et la mise en place d'un statut des enseignants-chercheurs plus proche du modèle universitaire.
Ce rapport, consacré à un premier bilan de la mise en oeuvre des décrets de février 2018 réformant les 20 écoles nationales supérieures d'architecture, constate que la réforme fait l'objet d'un consensus confirmé sur ses deux volets principaux : l'instauration d'une gouvernance des écoles plus participative, et la mise en place d'un statut des enseignants-chercheurs plus proche du modèle universitaire.
En revanche, sa mise en oeuvre a rencontré des difficultés d'application réelles, liées à l'ambiguïté des textes sur la gouvernance et à la variété des situations de chaque école, qui sont venues se greffer sur une situation budgétaire qui était déjà tendue. Ces difficultés se sont traduites par une forte pression sur les acteurs les plus impliqués directement : directions, nouvelles instances de gouvernance, et personnels administratifs.
Aussi, les rapporteurs formulent cinq séries de recommandations qui proposent de clarifier, préciser et achever la mise en place de la réforme, et d'en tirer les conséquences tant dans le fonctionnement de la tutelle exercée par le ministère de la culture, que dans l'accompagnement budgétaire des écoles.











