Architecture construction bois

Les défis du bois, édition 2019, ENSTIB.
Chaire "Architecture et Construction bois: du patrimoine au numérique"
Présentation:
La Chaire partenariale "Architecture et Construction bois: du patrimoine au numérique" est issue d'une démarche, à la fois scientifique et de terrain, menée depuis quelques années à l'Ecole d'architecture de Nancy et l'ENSTIB, qui a associé dès le départ, des territoires d'expérimentation et de projet.
L'objectif de cette chaire est de valoriser les potentiels du matériau bois, stratégique par son caractère renouvelable et recyclable, ainsi que par sa contribution à la lutte contre les changements climatiques. Faiblement énergivoire dans sa mise en oeuvre, il s'affirme comme l'un des matériaux de base dans la conception et la réalisation de bâtiments à hautes performances énergétiques et à impact environnemental nul. Le domaine de la construction bois est aujourd'hui en pleine évolution avec les outils numériques de conception (modélisation paramétrique, simulation dynamique, maquette numérique...) et de fabrication (machine à commandes numériques, robotique de chantier...). Le projet ambitionne de tirer parti des recherches actuelles en matière de continuum numérique, du contexte d'évolution très rapide des conditions de conception, de fabrication et d'organisation de la construction appliquées à la filière bois, en étudiant également les évolutions des pratiques, les freins et perspectives.
La Chaire bois travaille autour de 3 axes:
- L'histoire et le patrimoine
- L'emploi de nouvelles technologies dans la conception architectural et le travail du bois
- L'utilisation de la robotique dans les industries du bois
Partenaires:
Dans le cadre de cette chaire partenariale, l'Ecole d'architecture de Nancy et ses laboratoires de recherche (Centre de Recherche en Architecture et Ingénierie, Laboratoire d'Histoire de l'Architecture Contemporaine), l'Ecole d'architecture de Strasbourg, l'ENSTIB, le Pôle de compétitivité Fibres Energivie, le GIPEBLOR, FCBA et le CRITT BOIS ont identifié un intérêt à travailler ensemble pour la mise en oeuvre d'une chaire: "Architecture et Construction bois: du patrimoine au numérique".
Ce projet, bénéficiant du contexte national Plan recherche et innovation 2025 "Filière forêt-bois" et du Plan national d'action bois, s'adosse au contexte particulier de la présence sur le territoire Grand Est de l'ensemble des composantes de la filière bois-forêt, d'un Pôle de compétitivité Fibres Energie, de la structuration locale académique, de la présence de l'interprofession et de la forte mobilisation des collectivités. Cette chaire se donne la possibilité d'intégrer de nouveaux partenaires, tout au long de ses actions, dans l'objectif d'améliorer son fonctionnement et sa représentation au sein de la filière bois-construction.
Responsable scientifique:
Chaire "Architecture et construction bois - du patrimoine au numérique" : Franck Besançon / franck.besancon @ nancy.archi.fr
Contacts administratifs:
Cynthia Martin, cynthia.martin@nancy.archi.fr
Anxhelo Bici, anxhelo.bici@nancy.archi.fr
Projet d'étude Restauration Charpente Notre-Dame
Projet d'étude Restauration Charpente Notre-Dame
Chaire partenariale Architecture et Construction bois : du patrimoine au numérique
Master Génie Civil Architecture Bois Construction - ABC
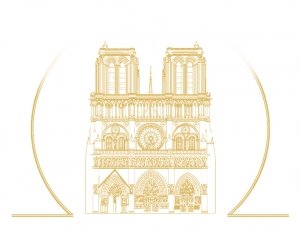
Restauration de la charpente bois et de la flèche de la cathédrale Notre-Dame de Paris
Le projet consiste à étudier une nouvelle toiture de la cathédrale Notre-Dame de Paris à la suite de l'incendie survenu les 15 et 16 avril 2019. Cette étude se fait en partenariat avec l'association Restaurons Notre-Dame (rND) créée au lendemain de l'incendie. L'association oeuvre en faveur d'une restauration de la charpente en bois dont l'un des fondements est le développement de propositions technologiques et architectoniques de la charpente et de la flèche pour la Cathédrale.
Le projet d'études s'appuie sur des acteurs universitaires nationaux et internationaux ainsi que sur un groupe de trente étudiants de Master 2 Génie Civil « Architecture Bois Construction » et de PFE (Projet de fin d'études d'ingénieurs) de plusieurs grandes écoles associées :
- l'école nationale supérieure d'architecture de Nancy,
- l'école nationale supérieure des technologies et des industries du bois (ENSTIB) d'Epinal,
- l'ESB à Nantes et
- HTW Saar à Sarrebruck (Allemagne).
Des experts du numérique, de la 3D et du BiM (Building Information Modeling) complètent ce comité et interagissent transversalement sur l'ensemble des thèmes. Ce projet d'études se répartit en six thèmes distincts qui permettent d'élaborer les différents scénarios de restauration :
- Thème 1 : Assemblages bois de la charpente de Notre-Dame de Paris
- Thème 2 : Les effets gravitaires et climatiques sur la charpente de Notre-Dame
- Thème 3 : La fabrication de la nouvelle charpente de Notre-Dame (intégrant notamment la qualité des bois)
- Thème 4 : L'impact environnemental de la toiture de Notre-Dame de Paris
- Thème 5 : Exploration des possibles pour la charpente, la flèche et la couverture de Notre-Dame de Paris
- Thème 6 : Restauration d'édifices patrimoniaux, études de cas comparées
Il s'agit également de travailler sur des modules paramétriques qui permettront de s'adapter à l'inconnu et aux aléas du diagnostic de l'état de la maçonnerie de Notre-Dame. Cela concerne principalement : les points d'appui de la charpente et de la flèche, le choix d'une ou de plusieurs essences, de la forme et de la géométrie de la charpente, du poids total de la toiture, du choix du matériau de couverture…
Les conclusions de ce projet d'études sont attendues pour le 1er trimestre de l'année 2021. Comme l'Association restaurons Notre-Dame s'y est engagée le 20 juin 2019 lors de son Assemblée Constituante, cette étude sera remise au Président de la République ainsi qu'aux autorités publiques en charge de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.
L'association Restaurons Notre-Dame
L'association française Restaurons Notre-Dame (rND) a été fondée le 20 juin 2019 à Paris. Elle mobilise l'ensemble des savoir-faire traditionnels et modernes, universitaires et professionnels pour assurer une restauration reconstruction de la Cathédrale dans les règles de l'art, et le respect des chartes et conventions en matière de patrimoine historique.
En savoir +
La Commission de coopération scientifique, technique et universitaire
Au cours du premier semestre 2020, l'association Restaurons Notre-Dame (rND) s'est dotée d'une Commission de coopération scientifique, technique et universitaire chargée de concevoir une nouvelle charpente en bois pour la cathédrale Notre-Dame de Paris.
Cette commission est pilotée par Franck Besançon, maître de Conférences à l'école nationale supérieure d'architecture de Nancy et directeur de la Chaire partenariale d'enseignement et de recherche "Architecture et construction bois : du patrimoine au numérique", labellisée par le ministère de la Culture en 2016, rattachée et associée au MAP-CRAI (Centre de recherche en architecture et ingénierie) et au LHAC (Laboratoire d'histoire de l'architecture contemporaine).
Gilles Duchanois, professeur-chercheur à l'école d'architecture de Nancy est également engagé dans cette instance.
L'ensemble des hypothèses émises lors de ce projet d'études conduira la commission de coopération scientifique, technique et universitaire à concevoir un prototype de charpente en bois paramétrable, évolutif et adaptable en fonction des connaissances et réponses qui résulteront des études et diagnostic en cours. Toutes les options, quant aux types de matériaux bois, à la modélisation géométrique, aux fonctionnalités et l'adaptabilité pourront donc être envisagées.
En savoir +
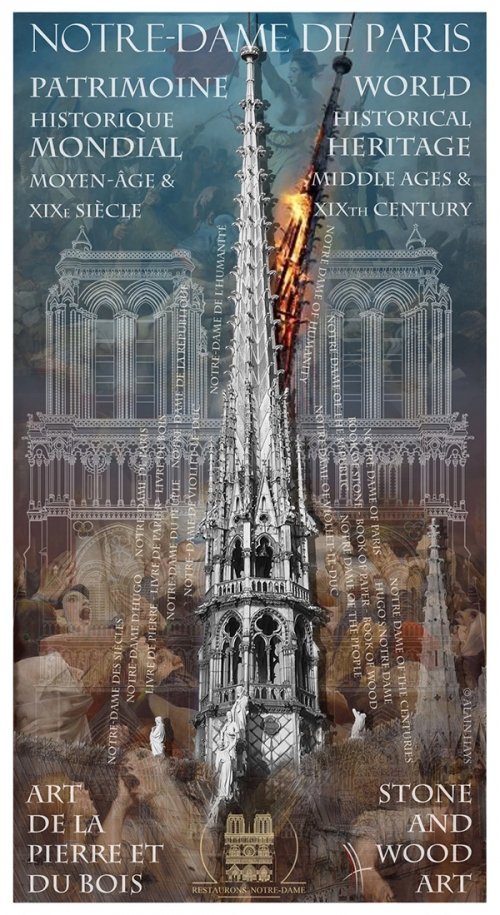
La DRAC Grand Est en parle
La DRAC Grand Est en parle
Doctorant MAP-CRAI aux journées scientifiques
du GDR 3544 Sciences du Bois
NOV. 2021
Doctorant MAP-CRAI aux journées scientifiques
Victor Fréchard, doctorant au laboratoire MAP-CRAI a présenté le contexte de sa thèse "Proposition d'une méthode de conception-fabrication pour l'architecture en bois. Application du procédé de Stratoconception®" à travers un flash-talk et un poster lors des 10e Journées Scientifiques du GDR 3544 Sciences du Bois qui se sont déroulées à Montpellier du 17 au 19 novembre 2021.
Diplômé du Master « Architecture Bois Construction », il a débuté sa thèse de doctorat en 2021, dans le cadre de la Chaire partenariale d'enseignement et de recherche "Architecture et construction bois : du patrimoine au numérique".
En savoir + sur la Chaire Bois 
Utilisation du procédé de Stratoconception® pour l'architecture en bois
Sujet de thèse
Utilisation du procédé de Stratoconception® pour l'architecture en bois
Sujet de thèse : "Contribution à l'étude de l'utilisation de la Stratoconception® pour la conception et la fabrication de composants non-standards pour l'architecture en bois"
Un projet de thèse est engagé par Victor Fréchard depuis le 1er janvier 2021 concernant l'application du procédé de Stratoconception® dans les pratiques de l'architecture et la construction en bois. Cette thèse est soutenue financièrement par le ministère de la Culture à hauteur de 50 % et par la Chaire Bois via ses partenaires industriels pour l'autre moitié.
Résumé :
Laboratoire : Laboratoire d'Étude et de Recherche sur le Matériau Bois (LERMAB)
Laboratoire d'accueil : UMR 3495 MAP-CRAI
Ecole doctorale : ED SIMPPÉ, Sciences et Ingénierie des Molécules, des Produits, des Procédés et de l'Énergie
Année d'inscription en thèse : 2020
Financement propre ou autre : Demi-financement MC et demi-financement entreprises partenaires de la Chaire "Architecture et Construction bois : du patrimoine au numérique"
Direction et co-direction : Laurent Bléron (directeur), Julien Meyer (co-directeur)
Mention de la thèse : Sciences du bois et des fibres
Contribution à l'étude de l'utilisation du procédé de Stratoconception® pour la conception et la fabrication de composants non-standards pour l'architecture en bois
L'architecture non-standard en bois explore l'étendue des possibilités techniques et esthétiques pour de nouveaux usages répondant à des exigences fonctionnelles cohérentes avec les enjeux environnementaux, sociétaux et économiques contemporains. Ce type d'architectures peut cependant se heurter à la complexité de leur réalisation en raison de la grande liberté formelle qui leur est associée, impactant directement leur efficience par rapport aux enjeux précédemment énoncés.
La fabrication additive, connue du grand public sous l'appellation « impression 3D », a été récemment introduite dans le secteur de la construction en apportant de nouvelles opportunités pour la conception et la fabrication de composants architecturaux multifonctionnels, d'une grande liberté formelle. Parmi l'ensemble des procédés de fabrication additive, la Stratoconception® apparait comme une solution prometteuse pour dépasser les limites des moyens de fabrication conventionnels de la construction en bois pour développer des architectures et des composants non-standards en bois tout en possédant une forte capacité d'adaptation aux moyens techniques et matériels utilisés par cette industrie.
Ce procédé de fabrication se limitait jusqu'à présent à la réalisation de maquettes et de prototypes de petites dimensions pour l'architecture et ne s'appliquait pas à la conception et à la fabrication de composants fonctionnels à usage structurel de petites comme de grandes dimensions. De plus, l'utilisation de ce procédé pour la réalisation de prototypes ou d'outillages pour l'industrie implique que la conception du processus de fabrication par Stratoconception® est indépendante de la conception des objets eux-mêmes, destinés à être réalisés par d'autres procédés de fabrication. Au contraire, l'architecture non-standard privilégie un renforcement du lien entre la conception architecturale et les techniques de fabrication.
Ce travail s'est alors dirigé vers le développement d'une base de connaissance, orientée vers des enjeux identifiés, des mécanismes, des problématiques et des limites de l'utilisation de la Stratoconception® dans les pratiques de l'architecture et la construction en bois. Nous avons identifié des opportunités d'applications du procédé pour la conception et la production de composants architecturaux non-standards, particulièrement les noeuds d'assemblages en bois de treillis tridimensionnels et les parois.
Afin d'obtenir un processus de conception flexible, informé, attribuant davantage de temps aux tâches créatives, et applicable dans les pratiques de l'architecture et de la construction en bois, nous avons introduit une méthode de conception pour la fabrication additive par Stratoconception® intégrant les contraintes et les opportunités du procédé dès l'étape de conception de la géométrie de la pièce en s'appuyant sur l'association des outils numériques de conception architecturale et de fabrication par Stratoconception®.
Ces travaux ont participé au montage des projets Stratobois et Mycobat et sont poursuivis par les travaux de thèse d'Anwar Nehlawi.
Pour plus d'explications sur le procédé de stratoconception® :
Digitalisation, réemploi et architecture circulaire.
Sujet de thèse
Digitalisation, réemploi et architecture circulaire.
Sujet : Digitalisation des éléments et matériaux des constructions existantes. Méthode, pratiques et outils numériques, dédiés à la systématisation du processus de réemploi et à une pratique architecturale circulaire.
Un projet de thèse est engagé par Maxence Lebossé à compter du 1er janvier 2022 dont le sujet est : « Digitalisation des éléments et matériaux des constructions existantes. Méthode, pratiques et outils numériques, dédiés à la systématisation du processus de réemploi et à une pratique architecturale circulaire ». Cette thèse est soutenue financièrement par le ministère de la Culture à hauteur de 50 % et par la Chaire Bois via ses partenaires industriels pour l'autre moitié.
Spécialité du doctorat : Sciences de l'Architecture
Résumé : Depuis plus d'une dizaine d'années que les démarches de réemploi réémergent et s'institutionnalisent, les opérations exemplaires se multiplient et les méthodes se précisent. Cependant les déconstructions restent sélectives et les projets ciblent des produits spécifiques du second-oeuvre. De l'extraction à la remise en oeuvre en passant par la conception, les architectes s'emparent du processus de réemploi et mûrissent des pratiques singulières issues de leurs expériences de terrains. Dans ce contexte, la massification du réemploi, étendu au gros-oeuvre reposerait sur une évaluation exhaustive et systématisée des gisements existants amenés à être déconstruits. D'une part, la réalisation d'un diagnostic ressources intégral engage de traiter une grande quantité d'informations dont la collection, la valorisation et la transmission, selon un langage et des méthodes communes sont encore peu automatisées et standardisées. D'autre part, années après années le BIM (Building Information Modeling) gagne en maturité et en adoption, et constitue un levier incontournable de massification du réemploi des éléments et matériaux de construction existants. La thèse se propose d'explorer, au travers d'expérimentations pratiques, les méthodes et outils, numériques comme matériels, employés et appropriables par les architectes dans leurs activités de réemploi. Notre objectif est d'évaluer, par l'usage, l'efficience et la pertinence des démarches de numérisation-virtualisation des ressources architecturales existantes. Des expérimentations qui seront menées au sein de différents projets, en alternant des périodes d'observation, de production, et d'exploitation d'applications et matériels numériques dédiés (crée en laboratoire, issu du marché ou des universités). Nos cas et terrains d'études se partageraient, entre des agences d'architectures et des bureaux d'études (AMO-A-E/MOE1), et le territoire du département des Vosges (MOA). Ce sur ce dernier que nous avons déjà pu engager des recherches portant sur le diagnostic de performances et de méthodes de dépose de bois d'oeuvre en vue de leur réemploi. Notre postulat est que le diagnostic ressources est à l'origine d'un mécanisme de création de valeur, vecteurs d'usages et donc d'extension du cycle de vie des éléments et matériaux. Un recueil automatisé des données sur le terrain permettrait à l'architecte d'optimiser ses tâches de relevés et de diagnostics afin de pouvoir se consacrer à l'identification des performances des solutions de réemploi. Au-delà d'assister l'architecte sur le terrain et à son bureau, la valorisation des données extraites, peut permettre de créer de la traçabilité et d'évaluer à terme les multiples impacts du processus de réemploi. Tant du point de vue écologique, que socio-économique, mais aussi, urbain et paysager.
Mots-clés : Architecture, Circularité, Digitalisation, Réemploi, Réutilisation, Ressources, Éléments et Matériaux de Construction, Bois, Massification, Évaluations, Valorisation, Valeur, Outils et Applications Numériques, BIM, SIG, Plug-In.

